
--------------------------------------------------------------------------------
L'installation d'une victime en position d'attente et de transport poursuit un double but : disposer le patient dans une posture qui vise à obtenir des conditions susceptibles de préserver ou d'améliorer ses fonctions vitales (conscience, état ventilatoire, état circulatoire), tout en veillant à ne pas aggraver d'éventuelles lésions traumatiques associées. Nous nous proposons de rappeler brièvement les indications de ces positions ainsi que les grandes lignes de leurs justifications physiopathologiques.
--------------------------------------------------------------------------------
Lors de l'abord d'une victime, une des premières questions à se poser est la suivante : "La position spontanément adoptée par le patient est-elle celle la mieux adaptée à son état ?". En cas de réponse négative, il convient d'estimer le rapport bénéfice / risque d'un éventuel changement de position. Si cette mobilisation ne pose généralement pas de problème dans le cadre des urgences médicales, il n'en est pas de même en traumatologie. Dans ce contexte, la hantise d'une lésion rachidienne imposera l'emploi de règles strictes de manutention (nécessitant la présence de plusieurs intervenants), seules garantes du respect de la rectitude de l'axe tête-cou-tronc. Une victime consciente aura, le plus souvent, tendance à adopter spontanément la posture dans laquelle elle se sent le mieux. Cette position sera généralement à respecter à condition qu'elle soit en accord avec les grands principes que nous allons rappeler ici.
Pour des raisons didactiques, il est pratique de classer les positions d'attente en quatre grandes catégories : les positions dérivées du décubitus dorsal, les positions dérivées du décubitus latéral, les positions dérivées de la position assise et le cas particulier du décubitus ventral. Les techniques spécifiques qui permettent d'installer le patient dans l'une ou l'autre de ces positions sont réputées acquises par les médecins (elles font partie des connaissances élémentaires de secourisme). Elles ne seront donc pas détaillées ici.
Positions d'attente dérivées du décubitus dorsal
Décubitus dorsal, à plat dos strict
La position à plat dos strict est indiquée chez tout patient en arrêt respiratoire ou cardio-respiratoire.

Elle permet la réalisation des manoeuvres de réanimation cardio pulmonaire de base (libération des voies aériennes, ventilation, massage cardiaque externe) ainsi que les gestes de réanimation spécialisée (choc électrique externe, intubation, abord veineux périphérique). Elle favorise la restauration d'un débit sanguin cérébral lors du massage cardiaque externe. Elle limite le risque d'hypodébit cérébral sans s'opposer au retour veineux.
Décubitus dorsal, membres inférieurs surélevés
Le décubitus dorsal avec surélévation des membres inférieurs est indiqué chez toute victime consciente présentant une hémorragie abondante (interne, externe ou extériorisée) ainsi que devant la constatation de signes d'hypovolémie sévère (collapsus, tachycardie ou bradycardie paradoxale, temps de recoloration cutané allongé, troubles de la conscience, ...).


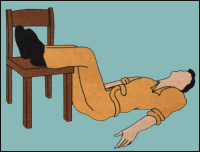
Dans le cas particulier de l'hémorragie extériorisée massive, il est bien évident que les mesures d'urgence visant à arrêter le saignement (compression manuelle, pansement compressif, point de compression) priment sur l'installation en position d'attente. Devant une plaie hémorragique du membre supérieur, la surélévation du segment de membre intéressé (s'il n'existe pas de fracture associée) améliorera l'efficacité des gestes d'hémostase. L'installation du patient en décubitus dorsal, membres inférieurs surélevés, peut en outre permettre de limiter les effets d'un malaise vagal. Cette position est contre-indiquée en cas de fracture des membres inférieurs ou du bassin. Son principe repose sur la redistribution d'une partie du sang contenu dans le système capacitif veineux des membres inférieurs, vers la partie supérieure du corps.
Décubitus dorsal, cuisses fléchies
Le décubitus dorsal, cuisses fléchies, les jambes étant disposées en position repliée ou horizontale est indiqué chez toute victime consciente présentant une plaie ou un traumatisme fermé de l'abdomen.

Elle est souvent spontanément adoptée par le patient conscient présentant une douleur abdominale aiguë. Elle permet de diminuer les phénomènes douloureux en favorisant le relâchement des muscles de la sangle abdominale.
Décubitus dorsal en position proclive de 10 degrés
Cette position est recommandée dans le cadre de la prise en charge des neurotraumatisés. Tous les brancards des ambulances modernes permettent de disposer la victime dans cette posture. Le but recherché consiste à diminuer l'oedème cérébral en favorisant le retour veineux. Cette position peut avoir un effet néfaste sur la tension artérielle, qui devra être recontrolée toutes les 10 mn.
Positions d'attente dérivées du décubitus latéral
Position Latérale de Sécurité (PLS)
La position latérale de sécurité est indiquée en cas de troubles isolés de la conscience, c'est-à-dire en l'absence de détresse respiratoire ou circulatoire associée.

Elle permet d'assurer un certain degré de liberté des voies aériennes (la tête de la victime est ramenée avec précaution vers l'arrière), et de limiter le risque d'inhalation du contenu gastrique (la bouche est légèrement ouverte et dirigée vers le sol). La mise en PLS constitue une manoeuvre à risques dans le cadre de la prise en charge d'un blessé potentiellement porteur d'une lésion du rachis cervical, mais même dans cette situation, c'est le risque vital qui prime devant l'éventuelle aggravation d'une lésion neurologique supposée. La technique de mise en PLS chez le blessé grave ou chez le polytraumatisé doit être connue de tous les intervenants de l'urgence (médecins et secouristes). Elle doit être réalisée en respectant scrupuleusement les recommandations officielles (enseignement du secourisme). Lorsqu'elle est effectuée à trois intervenants, elle permet de respecter l'axe tête-cou-tronc lors de la mobilisation de la victime. Il est fortement conseillé de mettre en place un collier cervical avant la mise en PLS. Remarquons que la PLS ne se justifie plus lorsque la liberté des voies aériennes est garantie par l'intubation. La mise en place d'une canule de Guedel, au contraire, ne dispense pas de la mise en PLS car si elle assure la liberté des voies aériennes elle ne protège pas contre l'inhalation accidentelle du contenu gastrique.
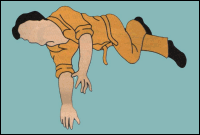
La PLS peut aussi bien être réalisée à droite qu'à gauche. En cas de fracture d'un membre la victime sera classiquement tournée du côté lésé, mais selon les circonstances et le siège de la lésion, le positionnement du coté sain, de manière à ce que le poids du corps ne comprime pas le membre lésé, nous paraît être également une solution acceptable. Si on a le choix, on préférera néanmoins tourner la victime sur le côté gauche afin de pouvoir la surveiller plus facilement une fois qu'elle sera installée dans l'ambulance ou dans le VSAB (véhicules normalisés avec porte brancard à gauche). Dans le cas particulier du traumatisé thoracique présentant des troubles de la conscience, la PLS sera réalisée du côté de la lésion afin de favoriser l'efficacité des mouvements ventilatoires du poumon sain.
Position obstétricale (ou PLS gauche)
La position obstétricale ou PLS gauche est indiquée pour le transport de toute femme enceinte (même si elle est consciente) à partir du 7 ème mois de grossesse. Elle permet de supprimer la compression exercée par le poids de l'utérus gravide sur la veine cave inférieure.
Positions d'attente dérivées de la position assise
Position assise (membres inférieurs pendants)
La position assise au bord du lit (ou sur une chaise) est indiquée chez tout patient présentant une détresse respiratoire consécutive à la survenue d'un oedème aigu du poumon. Elle est souvent adoptée spontanément par la victime, qu'il n'est pas rare de trouver également debout, penchée dans l'embrasure d'une fenêtre (soif d'air). Cette posture permet de diminuer le retour veineux (précharge ventriculaire gauche) et, conséquemment, la pression artérielle pulmonaire.
Position demi-assise (membres inférieurs allongés)
La position demi-assise stricte est indiquée en cas de gêne respiratoire ou de détresse respiratoire chez un malade conscient (crise d'asthme par exemple).

Cette posture améliore l'efficacité des mouvements ventilatoires en facilitant le jeu du diaphragme, ainsi soulagé du poids des viscères abdominaux. S'il existe une gêne ventilatoire consécutive à une blessure thoracique, le patient peut également être maintenu dans cette position, mais tourné vers le côté lésé.

Le blessé indique alors lui même dans laquelle de ces deux positions il se sent le mieux.
Position demi-assise (membres inférieurs fléchis)
La position demi-assise, membres inférieurs fléchis constitue un cas particulier. Elle représente une combinaison de deux positions dont nous avons déjà parlé. Elle est indiquée en cas de traumatisme thoraco-abdominal. La composante thoracique est améliorée par la position demi-assise, la composante abdominale par la flexion des membres inférieurs. Avant d'adopter cette position, il est préférable de s'assurer de l'absence de lésions des membres inférieurs, du bassin et du rachis. En cas de doute, on respectera la position initialement adoptée par le patient.
Position assise, patient penché en avant
La position assise, patient penché en avant, est indiquée dans le cadre de la prise en charge et du transport des enfants (mais aussi des adultes) présentant une épiglottite. Dans ce contexte, il faut rappeler que tout passage en position allongée est strictement contre-indiqué (risque de détresse respiratoire aiguë par obstruction brutale des voies aériennes supérieures), sauf si la victime est préalablement intubée ou si un abord transtrachéal a été réalisé. Cette position limite la gêne respiratoire et s'oppose en partie au risque d'obstruction des voies aériennes par l'hypertrophie inflammatoire de l'épiglotte. Cette posture convient également en cas d'épistaxis (on demande au patient de réaliser simultanément une compression nasale manuelle) car elle permet de limiter le risque d'écoulement sanguin postérieur.
Décubitus ventral
L'installation et le transport d'un malade en décubitus ventral reste une indication d'exception.

Cette posture, particulièrement inconfortable est, en effet, susceptible d'aggraver une gêne respiratoire préexistante. Elle perturbe également la surveillance clinique du patient en empêchant l'accès aux voies aériennes (intubation) et au thorax (auscultation cardiaque, contrôle de l'ampliation thoracique). Elle n'est indiquée que lors de la prise en charge d'une victime présentant des lésions hyperalgiques (plaies ou brûlures) de la face postérieure du tronc, à condition qu'il n'existe pas d'association avec une atteinte des fonctions vitales. Rappelons pour mémoire que le décubitus ventral peut être utilisé, dans un but thérapeutique, chez le patient de réanimation (intubé et ventilé) dans le cadre de la prise en charge du Syndrome de Détresse Respiratoire de l'Adulte (SDRA).
Conclusion
La période de transport d'un malade ou d'un blessé grave constitue toujours une étape "à risques" au cours de laquelle les perturbations liées au déplacement de la victime (vibrations, accélérations, décélérations, mouvements d'inclinaison) contribuent à aggraver son état. Lors du transport et durant la phase qui le précède, la connaissance et l'utilisation d'un certain nombre de règles simples dans la procédure d'installation du malade sont fondamentales. Si ces techniques reposent avant tout sur des principes élémentaires de secourisme, ces positions ne perdent cependant rien de leur intérêt lors de la phase de médicalisation des secours. Elles doivent donc être connues et utilisées par le médecin, ne serait-ce que pour vérifier que la position de la victime (spontanée ou imposée par les secouristes) est adaptée à son état neurologique, ventilatoire et hémodynamique ainsi qu'à la nature de ses lésions. L'utilisation de ces postures ne dispense en aucun cas de la surveillance de la victime, dont l'état clinique peut se modifier à tout instant et nécessiter une adaptation rapide de la stratégie de prise en charge.